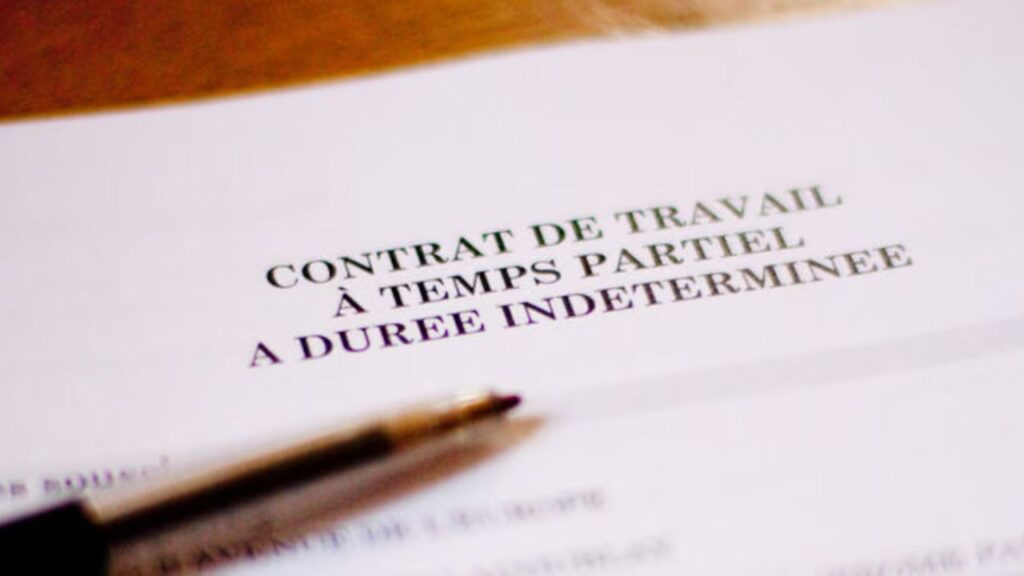Un CDI, c’est souvent perçu comme le Graal du salarié. Mais que faire si, une fois la signature posée, le doute s’installe ? Peur de s’être trompé, meilleure offre ailleurs, ou simple angoisse post-engagement : peut-on vraiment revenir en arrière après avoir signé un contrat à durée indéterminée en France ? Puis-je me rétracter après avoir signé un CDI ?
Sommaire
Mauvaise nouvelle : la rétractation n’existe pas
Contrairement à certains contrats commerciaux (comme un achat à distance), le droit du travail français ne prévoit aucun délai de rétractation pour un CDI. Autrement dit : une fois que vous avez signé, vous êtes engagé, même si vous n’avez pas encore commencé à travailler.
Cette absence de droit au « changement d’avis » repose sur un principe simple : la signature vaut engagement des deux parties. L’employeur s’engage à vous embaucher, et vous, à venir travailler à la date prévue. Mais, il existe plusieurs manières de se retirer proprement sans tout casser.
Se rétracter après signature d’un CDI : avant la prise de poste, prévenir au plus vite
Si vous n’avez pas encore commencé à travailler, la loi ne prévoit pas formellement de « rétractation », mais vous pouvez refuser d’honorer le contrat avant son exécution. En pratique, cela revient à rompre le CDI avant son entrée en vigueur.
Aucune procédure officielle n’est fixée, mais la bonne conduite consiste à informer l’employeur immédiatement, par écrit (mail ou courrier). Vous devez expliquer les raisons du désistement avec tact (exemples : changement de situation personnelle, autre proposition, etc.) Surtout, veillez à vous excuser du désagrément et évitez tout silence radio.
Notez que si le contrat précisait une date de prise de fonction, il n’a d’effet qu’à partir de ce jour-là. Tant que vous n’avez pas commencé à travailler, vous ne pouvez pas être accusé d’abandon de poste, mais l’employeur peut éventuellement réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice prouvé (exemples : remplacement urgent, dépenses engagées). En pratique, cela reste rarissime.
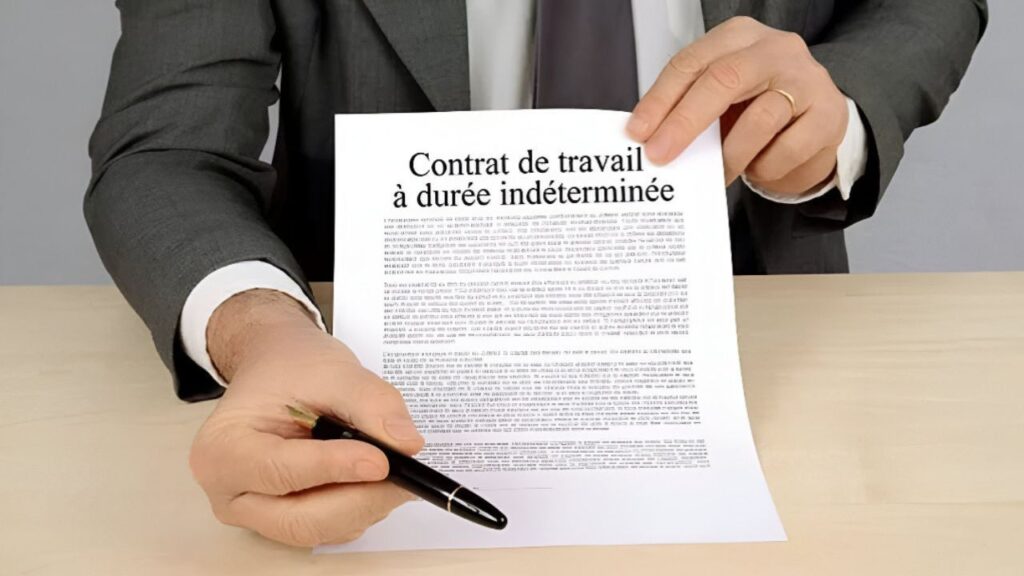
VOIR AUSSI : Combien d’heures faut-il travailler pour toucher le chômage en France ?
Après avoir commencé : la période d’essai
Une fois le poste démarré, la seule voie de sortie rapide, c’est la période d’essai. C’est justement sa fonction : permettre à l’un comme à l’autre de « tester » la collaboration avant l’engagement définitif.
Pendant cette période, vous pouvez rompre le contrat à tout moment, sans justification, à condition de respecter un délai de prévenance : 24 heures si vous êtes là depuis moins de 8 jours ou 48 heures si vous avez travaillé plus de 8 jours.
Là encore, un mail ou une lettre suffit. C’est légal, propre, et sans conséquence sur vos droits (notamment le chômage, si vous avez travaillé au moins 65 jours ailleurs avant).
NuMedia est un média indépendant. Soutiens-nous en nous ajoutant à tes favoris sur Google Actualités :